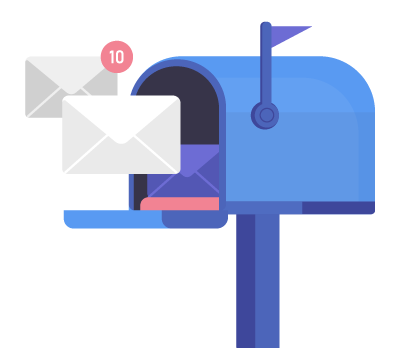Quel est le rôle de la psychanalyse dans l'émergence de la supervision ? Comment le travail social a-t-il contribué au développement de la supervision ? En quoi le coaching a-t-il renouvelé la pratique de la supervision ? Quelles sont les spécificités de la supervision des coachs ? Quels sont les défis et les perspectives d'avenir pour la supervision ?
C'est à toutes ces questions que répond notre ex-présidente Martine Volle dans une série de articles à ne pas manquer !
Ces articles sont des transcriptions d'enregistrements audio effectués par Martine à notre demande. Nous avons conservé la forme naturelle du langage parlé…
Episode 1 : Les racines de la supervision : psychanalyse et travail social, un duo fondateur
Bonjour à chacun et à chacune.
J’ai le plaisir aujourd’hui de partager avec vous ma vision subjective de l’histoire de la Supervision.
Alors pourquoi subjective ?
Parce que je suis plus sensible à certains événements qu’à d’autres. Pour autant, ce sont des faits historiques sur lesquels je m’appuie.
La psychanalyse
La Psychanalyse a eu un rôle très important dans les années 1920. Des échanges entre les grands psychanalystes, Freud, Jung, Ferenczi, montrent l’intérêt de pouvoir échanger avec des pairs. Et puis arrive 1925 (Congrès international de psychanalyse à Berlin) où cet intérêt a pris encore plus d’importance car les analystes éprouvent le besoin de disposer d’un espace d’élaboration de la relation transférentielle dans le travail avec les patients. C’est pourquoi cette façon de travailler se formalise et va s’appeler analyse de contrôle. On ne parle pas encore de supervision à l’époque. Pour autant, cette analyse de contrôle vise aussi à avoir une surveillance sur les nouveaux, les juniors, qui vont pouvoir échanger sur cette relation transférentielle.
Bien sûr les choses s’auto-imprègnent puisque chacun à partir de cette analyse de contrôle, chacun de ces milieux vont continuer à travailler le sujet.
C’est alors qu’arrivent en 1939 les groupes d’analyses de la pratique Balint. Ce médecin a l’idée d’utiliser le travail contre-transférentiel et d’investiguer le travail à l’égard de son patient. En ayant recours à l’association libre des idées au cours d’échanges qui, eux, se font en groupe.
Les travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux, notamment, vont être très intéressés par ce travail pour compléter les dispositifs qu’eux-mêmes emploient pour travailler en groupe. Ça, c’est l’autre branche de la supervision dont on parle peut-être moins. C’est une autre branche qui, elle, naît dans les années 1880 aux États-Unis où il y a des institutions de charité qui ont des bénévoles qui s’occupent de personnes en souffrance et qui s’aperçoivent que ces bénévoles eux-mêmes sont auteurs de la souffrance des gens dont ils s’occupent.
C’est ainsi que va apparaître l’arrivée du Case Work.
Et le Case Work : ce sont des études de cas. 1903 Mary Richmond va écrire pour la première fois un livre sur les Case Work qui en explique la technique. Elle va même lancer des formations courtes. Là on est dans le champ des travailleurs sociaux et du médico-social. Où il s’avère vital pour tous ces professionnels d’avoir un lieu collectif, cette fois pour échanger sur des cas.
Ce qui est intéressant c’est que je parle de 1903 aux États-Unis. Il faut ne pas oublier que c’est aussi une époque migratoire où les bénévoles aux États-Unis s’occupent des migrants qui arrivent par bateaux entiers de l’Europe et qui sont aussi dans une grande souffrance. Là encore, il est jugé important qu’il y ait de la supervision pour les professionnels qui accompagnent ces bénévoles. Ainsi ces bénévoles sont accompagnés par des formateurs et ces formateurs eux-mêmes sont supervisés. Alors on ne parle pas de supervision à l’époque, on parle d’espace de parole, on parle d’espace d’échanges.
La porosité
J’ai parlé du travail de Mr Balint, médecin. Mais Énid Balint, son épouse va aussi probablement influencer son mari Mickael Balint, puisqu’elle vient du champ du travail social et qu’elle connaît les équipes et le travail en équipe.
Ainsi on peut bien comprendre comment il y a de la porosité qui va se créer et des influences, mutuelles finalement, qui vont se mettre à l’œuvre. Car l’analyse de type BALINT permet de faire un travail subjectif aussi sur le praticien. Alors que peut-être les études précédentes portaient davantage sur du travail des situations vécues par les praticiens. On comprend dans ces années-là l‘influence de l’émotionnel, des affects qui viennent se glisser dans les relations…
Les années 50…
Pour avancer un peu sur le sujet, je vais passer après la guerre.
On se retrouve dans les années 1950.
Cette technique de travail va se répandre en France par Marguerite Pohek qui diffuse cette façon de travailler en 1950 en Autriche, en 1951 dans les Pays-Bas, 1952 en Finlande, 1953 en Italie, en Grande-Bretagne et enfin l’arrivée en France.
C’est vital de comprendre qu’ il y a une appétence et une importance à travailler les situations vécues par les professionnels de l’accompagnement qui, à chaque fois, peuvent se sentir en souffrance. Il n’y a pas que la souffrance qui est traitée dans ces groupes d’analyse de contrôle ou dans ces groupes d’analyse de la pratique. Il peut y avoir le geste professionnel aussi puisque, prenons l’exemple des USA, certaines formations de psychothérapeutes sont réalisées par la supervision et non pas sous la supervision.
Les courants se mélangent
Nous avons tendance à penser que la supervision s’occupe des professionnels déjà formés.
J’ai souvent dit que la supervision n’est pas de la formation initiale. Il peut y avoir une dimension didactique et certes, une dimension de formation continue dans la supervision, mais pas de formation initiale.
Or, elle a pu être aussi utilisée en formation initiale puisqu’en mettant directement les personnes sur le terrain et en les accompagnant grâce à la supervision, grâce à l’étude de cas, il était aussi possible de surveiller le geste professionnels, de l’affiner et de permettre à ces professionnels de le penser et de l’ajuster.
Et d’ailleurs, n’oublions pas que le siècle dernier, surtout à partir des années 50, les sciences humaines ont explosé. Il y a eu énormément de pratiques dans les sciences humaines qui arrivent, qui remettent aussi peut-être en cause des façons de travailler traditionnelles, des psychanalystes notamment, qui continuent d’ailleurs à avoir leur place.
Je pense à l’arrivée du courant de l’école Palo-Alto, à la cybernétique de 2ème ordre, l’arrivée de la systémique et de la réflexivité qui se développe, aussi bien dans le champ des travailleurs médico-sociaux, socio-éducatifs que dans le monde de l’éducation.
Donc là encore, on voit que les informations circulent, se développent…
Et en France ?
En France, on a l’arrivée de Myriam David, qui est psychiatre et psychanalyste. Elle ne parle pas forcément de supervision, mais on est dans le champ de l’aide sociale, par exemple l’aide sociale à la SNCF. Il y a eu de l’aide sociale qui s’est développée avec les Assistantes sociales qui étaient salariées de la SNCF (1950/60). On a eu dans les années 67 en France, Jacques Salomon qui lui met en place de la supervision pour l’éducateur, même si elle est réalisée par des psychologues. Et là on est dans un type de travail qu’on appelle psychopédagogique.
Pendant les années quatre-vingts, 90, nous avions de la supervision dans le milieu socio-éducatif, nous avions de l’analyse de la pratique réalisée par une psychologue. Car nous étions dans les quartiers avec des publics très sensibles. Et c’était vital pour nous d’avoir un lieu pour prendre du recul sur ces pratiques.
Il y a aussi d’autres personnes. Je pense à Jean Ughetto qui préconise le le travail des cas pour les éducateurs. Là, on est dans les années 50.
Retrouvez la suite de cette narration dans l’épisode 2 : Arrivée du coaching et évolution de la supervision